 Juin
14
2016
Juin
14
2016
Carolyn Steel : « L’alimentation offre l’opportunité de se ménager une vie meilleure »
La traduction française de Ville Affamée, ouvrage écrit en 2008, vient de paraître aux éditions Rue de l’échiquier. L’occasion d’interroger son auteure, l’architecte anglaise Carolyn Steel, sur les relations complexes que les sociétés urbaines contemporaines entretiennent avec la nourriture, depuis sa production jusqu’au traitement des déchets…
« Les villes, comme les gens, sont ce qu’elles mangent. »
Placé en quatrième de couverture de l’édition française, cet aphorisme souligne toute l’originalité de Ville affamée. Touchant à l’histoire de la vie quotidienne, à l’anthropologie, à la sociologie, l’économie, la géographie ou encore l’urbanisme, cet ouvrage de l’architecte anglaise Carolyn Steel décrit la façon dont la question alimentaire a façonné les villes depuis l’apparition des premiers groupements sédentaires à la fin de l’ère glaciaire jusqu’à l’avènement après la seconde guerre mondiale d’une civilisation entièrement dominée par l’urbain. Au gré d’une démonstration passionnante où sont tour à tour abordés la production agricole, l’approvisionnement et la logistique, la cuisine, la gestion des déchets et l’aménagement urbain, l’auteur y décrit un impitoyable processus de concentration doublé d’une invisibilisation croissante : non seulement l’alimentation des villes contemporaines dépend désormais presque en totalité des géants de l’agro-alimentaire, mais ceux-ci contribuent à rendre abstraits et insaisissables les processus grâce auxquels nous nous nourrissons – autorisant pêle-mêle le gaspillage, les plats préparés façon lasagnes au cheval, la maltraitance animale dans l’élevage intensif, la crise du monde agricole ou la malbouffe. Dans un contexte marqué par le changement climatique et l’explosion démographique, nourrir les villes est pourtant une question cruciale – sinon LA question. Aussi Carolyn Steel plaide-t-elle en faveur d’une Sitopie, c’est-à-dire d’une ville comestible où la production, l’acheminement et la consommation des denrées alimentaires seraient entièrement renégociés. Rencontre.
Midionze – Comment avez vous été amenée à vous intéresser aux relations entre villes et alimentation ?
Carolyn Steel – J’ai toujours voulu être architecte, mais dès mes études, j’ai découvert que quelque chose me manquait, qui n’était jamais discuté dans les écoles d’architecture, à savoir la question des usages et de la vie quotidienne. Je suis londonienne, et je voulais tout simplement parler de la ville de la manière dont je la connaissais. J’étais aussi intéressée par les pratiques culturelles et j’ai longtemps cherché comment relier cette question à celle de l’architecture. Après vingt ans de recherche, au cours desquelles j’avais utilisé la nourriture avec mes étudiants comme moyen de rendre certaines idées concrètes, j’ai enfin trouvé : je voulais décrire la ville à travers la question de l’alimentation. J’ai très vite décidé de décrire le trajet des aliments à travers la ville. Nous étions en 2000. Il m’a fallu sept ans pour écrire l’ouvrage et trouver un éditeur, ce qui n’a pas été chose facile, car les éditeurs, même s’ils étaient intéressés, avaient du mal à comprendre quel était mon sujet d’étude. Le livre, il est vrai, est pluridisciplinaire, car la nourriture touche à tous les domaines. Je me suis rendue compte assez vite qu’en écrivant sur un tel sujet, j’écrivais sur la civilisation !
MO – Comment appréhende-t-on la relation entre ville et alimentation quand on est architecte ?
CS – En tant qu’architecte, j’ai besoin de visualiser les choses pour comprendre comment elles fonctionnent. Quand on regarde une carte de Londres, on saisit aussitôt que la ville a été façonnée par l’alimentation. Certaines rues suivent encore le tracé des troupeaux qui étaient acheminés depuis l’Ecosse jusqu’au marché de Smithfield et leur largeur atteste encore aujourd’hui de cette activité. Idem pour le poisson qui arrivait sur la Tamise, et dont Fish street porte la mémoire. L’alimentation, plus encore que toute autre activité, se reflète dans l’architecture et la forme des villes. Avant l’ère industrielle, toute la journée était consacrée à la production alimentaire.
MO – Dans Ville affamée, vous expliquez que l’invention même des villes est très liée à l’agriculture. Dans quel sens ?
CS – Les chasseurs-cueilleurs dépensaient beaucoup d’énergie à chercher leur nourriture et il leur était impossible de faire des réserves. Ils suivaient la nourriture. L’agriculture et les villes se sont développées ensemble à la fin de l’ère glaciaire : avec le changement climatique, la population a crû, mais pas les réserves de nourriture. Les gens ont commencé à manger des céréales, ce qui implique d’être près des grains quand ils arrivent à maturité. D’où l’installation de communautés fermières sédentaires. Pour certains philosophes, comme Rousseau, la naissance de l’agriculture est en quelque sorte le début de la fin. De la même manière, de nombreuses mythologies, et notamment la Bible, présentent le travail aux champs comme une punition. De fait, la naissance de l’agriculture est marquée par une baisse de l’espérance de vie. Mais elle voit aussi se développer l’administration, le stockage des grains, la propriété privée, et surtout de la production de surplus, et avec elle l’apparition du commerce. Les premières villes sont aussi régies par le zonage, fondé sur la division du travail.
MO – Vous décrivez aussi les relations entre la ville (consommatrice) et l’hinterland (productif). Aujourd’hui, comment ces relations ont-elles évolué avec l’industrialisation ?
CS – Aujourd’hui, les villes ont un hinterland global. La production alimentaire se fait partout. L’autre fait marquant de la modernité est que l’approvisionnement des villes n’est plus assuré par les autorités, qui n’en ont plus le contrôle, mais par l’industrie agro-alimentaire.
MO – Vous décrivez un approvisionnement urbain agro-industriel marqué par l’invisibilité à toutes les étapes de la chaine, de la production alimentaire aux déchets. Quels sont les effets ?
CS – Nos sociétés maintiennent physiquement et mentalement la nourriture à distance. Dans la ville pré-industrielle, le marché était au cœur de la ville, il était très visible car il constituait une activité essentielle, contrôlée par les autorités (il était par exemple illégal de vendre des denrées hors du marché). Quand le chemin de fer est arrivé, les industriels ont commencé à conserver les aliments, que ce soit en les congelant ou en les conditionnant. Les contraintes géographiques qui présidaient à l’approvisionnement des villes ont alors disparu. Cette évolution a des effets non seulement sur la manière dont les produits sont acheminés, mais sur le régime alimentaire lui-même, certains produits comme le lait étant soudain disponibles. De même, la nourriture, qui occupait le cœur des villes, avec ce que cela suppose de vie sociale, s’est alors déplacée de manière graduelle vers les périphéries. La logistique, qui est aujourd’hui la question centrale quand on étudie les relations entre ville et alimentation, veut être efficace, ce qui n’est pas compatible avec la forme des villes anciennes, où circuler est un cauchemar. Quand les supermarchés ont commencé à s’installer en périphérie et à y proposer des denrées périssables, les petits commerces des centres-villes ont donc commencé à mourir. L’impact de l’industrialisation est aussi culturel. Plus vous êtes riche, moins vous avez à vous soucier de votre alimentation : le roi ne fait pas de jardinage, on lui sert à manger. L’industrialisation nous place tous dans cette position privilégiée de ne pas voir à penser à la production alimentaire. Cultiver un jardin ou cuisiner (surtout dans l’espace domestique) ont toujours été des activités méprisées, comme autant de signes d’un statut social peu élevé…
MO – L’industrie agro-alimentaire permet d’approvisionner les villes avec un degré d’efficacité jamais atteint, et pourtant vous montrez que nous n’avons jamais été aussi vulnérables. En quoi ?
CS – Les sources de vulnérabilité sont nombreuses. Dans un contexte où l’approvisionnement est local, ce dernier ne dépend pas du réseau électrique, ni des grèves ou des transports. Au contraire, quand la nourriture est produite à 10 000 kms, il peut y avoir 10 000 problèmes au moment de l’acheminement – catastrophes naturelles, troubles politiques, crise énergétique, etc. Par ailleurs, dans le monde pré-industriel, il était interdit pour un même acteur d’intervenir à plusieurs maillons de la chaine d’approvisionnement : un meunier ne pouvait pas être céréalier ni boulanger. Aujourd’hui, l’approvisionnement est concentré aux mains de grands groupes, qui interviennent à toutes les étapes et ne dépendent plus des gouvernements. Par ailleurs, les stocks sont très concentrés, ce qui les rend vulnérables au bioterrorisme. La question du « just-in-time » pose aussi problème : en cas de grève ou pour d’autres raisons, les supermarchés pourraient manquer d’approvisionnement en quelques heures, et comme les gens ont perdu l’habitude de stocker de la nourriture et de cuisiner, ils pourraient se retrouver rapidement à court de vivres. Sans parler des problèmes liés à l’agriculture intensive : épizooties, résistance aux antibiotiques, etc.
MO – Vous évoquez aussi l’appauvrissement génétique lié à la standardisation des denrées alimentaires…
CS – Oui, et c’est sans doute le point le plus important : l’industrialisation conduit à restreindre de beaucoup la diversité et le nombre des variétés cultivées. Dans le livre, je prends l’exemple de ce champignon qui a éradiqué la quasi-totalité de la production mondiale de bananes. La catastrophe a pu être évitée grâce à la découverte d’une variété résistante. Le problème, c’est qu’en défrichant la forêt vierge pour produire de l’huile de palme, nous détruisons aussi les variétés de bananes qui nous permettraient de trouver des remèdes aux maladies. En perdant cette biodiversité, on perd aussi toute capacité à mobiliser des alternatives en cas de problème.
MO – Pour un lecteur français, le constat que vous dressez dans votre livre peut sembler très sombre. Entre les AMAP, l’essor du bio et l’impact des récents scandales alimentaires sur la consommation de viande, il y a ici un mouvement de plus en plus fort en faveur d’une nourriture de qualité…
CS – Oui, en effet, ce mouvement existe aussi en Angleterre, et il est bien plus fort qu’au moment où j’ai écrit le livre en 2008. On est typiquement face à un effet de balancier : quand un phénomène a trop d’impacts négatifs, il entraine une réaction. Ici en l’occurrence, il s’agit d’une réaction à l’industrie agro-alimentaire. J’ai grandi à une époque où le balancier allait dans l’autre sens : il y avait des commerces de proximité, on connaissait les commerçants par leur nom, ma mère cuisinait tous les jours et nous prenions nos repas ensemble. Ce modèle traditionnel a été balayé par l’apparition des supermarchés et par la libération des femmes. La Grande-Bretagne, grande nation industrielle, n’a offert aucune résistance à l’industrie agro-alimentaire, au contraire. En France et en Italie, la résistance a été beaucoup plus forte, grâce à des personnalités comme José Bové ou des mouvements comme Slow Food. Cela dit, les Français sont aujourd’hui les premiers consommateurs de Mc Donald. La nourriture industrielle est semblable à un tsunami, et s’imposera partout dans un futur proche. L’aspiration des classes favorisées à une nourriture saine reste une petite niche. En Angleterre par exemple, la mise en question des plats préparés ou du gaspillage portée par des chefs comme Jamie Oliver est perçue comme un phénomène de riches et ne touche pas les classes sociales moins aisées.
MO – La dernière décennie a vu se multiplier les projets d’écoquartiers. Pourtant, malgré leur supposée exemplarité, la question de l’approvisionnement alimentaire y est très largement absente. Comment l’expliquez-vous ?
CS – L’alimentation est un phénomène très simple et très complexe à la fois. La nécessité de se nourrir est universelle. La complexité est que chaque culture, chaque famille, chaque indidivu a sa propre représentation de la nourriture, raison pour laquelle réglementer l’alimentation à travers des préconisations et des interdits est presque impossible politiquement, et d’autant plus que c’est aussi une question qui divise la société, et reflète un vrai conflit de classes. De plus, beaucoup de projets d’écoquartiers sont des « vanités », du pur marketing pour « starchitectes ». La question de l’alimentation s’y réduit à un toit végétal ou un peu d’aquaponie, mais rien qui soit de nature à subvenir aux besoins d’une ville entière. Nourrir une ville avec ses propres ressources n’a jamais été possible. Les premières villes étaient des cités-Etats, avec un cœur urbain et un hinterland rural. Une ville compacte réclame un hinterland dix fois plus étendu. Si la ville est plus dense, l’hinterland doit croître en proportion. C’est la raison pour laquelle les fermes verticales ne fonctionnent que pour certains fruits et légumes – en gros les salades. L’agriculture a besoin d’espace.
MO – Quelle pourrait alors être l’alternative à l’industrie agro-alimentaire globalisée ? Une production locale est-elle encore possible aujourd’hui ?
CS – Oui, une telle agriculture est possible. Pour cela, il faut se poser une série de questions. Première d’entre elles : quel type de campagne et d’agriculteurs voulons-nous ? Sommes nous prêts à prendre en compte la distance parcourue par les denrées alimentaires ? La question des « food miles », même si elle est complexe (des études ont montré qu’il était plus « vert » de produire des tomates en Espagne et de les acheminer par train que de les produire directement dans des serres chauffées en Angleterre), est importante. Il faut aussi adapter son alimentation au rythme des saisons et arrêter de compter sur cet éternel été global qui fait qu’on trouve désormais partout des tomates en hiver. Et bien sûr, valoriser les agriculteurs qui travaillent de manière écologique et imitent les processus naturels, comme c’est le cas de la permaculture. Enfin, je crois qu’il faut surtout réévaluer l’importance que nous accordons à la nourriture, et la remettre à sa juste place, et la considérer pour ce qu’elle est. A savoir : ce qui donne forme à notre monde et nous reconnecte à la nature, aux saisons, et aussi les uns aux autres. Aux Etats-Unis, un repas sur cinq est pris dans une voiture, car tout le monde est trop occupé pour prendre le temps de manger. Mais qu’avez-vous à faire de si important qu’en 24h vous n’ayez pas le temps de manger ? Ecrire des tweets ou regarder l’écran de votre iPhone ?
MO – Le budget que nous accordons à l’alimentation va dans ce sens. Il n’a jamais été aussi bas…
CS – Et pourtant, l’alimentation bon marché est une fiction, qui a été créée délibérément et entretenue par l’industrie agro-alimentaire et les politiques, qui ont tout intérêt à nous faire croire que la nourriture ne vaut rien. Mais si la nourriture est bon marché, vous ne lui accordez aucune valeur, donc vous la gaspillez, vous la jetez, etc. Les seuls qui accordent de l’importance à la nourriture sont ceux qui en manquent.
MO – Aujourd’hui, à quoi ressemblerait une ville entièrement conçue en fonction de ses relations à la production alimentaire ?
CS – Les gens me reprochent souvent d’être nostalgique et de plaider pour un retour aux formes anciennes de villes. De fait, les villes dans le monde médiéval et pré-industriel n’avaient pas d’autre choix que d’être « durables ». La Sitopie que j’appelle de mes vœux serait une ville où les gens percevraient la vraie valeur de l’alimentation, et la tiendraient pour un sujet de réflexion de premier plan et une activité gratifiante. Sitopia ressemblerait en somme à une ville ancienne, mais avec des immeubles modernes : elle aurait des espaces publics où la nourriture serait vendue, des maisons où les gens feraient pousser des fruits et légumes dans la cour ou le jardin, et aussi des restaurants et des cafés ayant maintenu un contact avec de petits producteurs. Il importe de ne pas laisser les villes grossir jusqu’à devenir des endroits totalement improductifs et attendre que l’alimentation surgisse de nulle part. Nous devons repenser tout cela et considérer à nouveau les villes comme productives.
MO – Votre livre a été publié en 2008. Quelles évolutions constatez-vous depuis ?
CS – Les choses ont beaucoup changé. Quand Ville affamée est sorti, la crise économique est venue confirmer le fait que le système agro-industriel arrivait à un point de non-retour. Les gens ont aussi pris conscience de ce que j’essaie d’exprimer dans le livre, à savoir que l’alimentation offre l’opportunité de se ménager une vie meilleure et de se questionner sur ce que serait une telle vie. On commence à comprendre que l’agriculture industrielle est efficace en termes de rendement, mais qu’elle ne fournit pas d’emplois, et qu’elle exclut l’être humain. Idem pour l’aménagement urbain : la question alimentaire en a été la grande absente, à de rares exceptions près, comme les cités-jardins de Howard. Depuis que le livre est sorti, des gens viennent me voir qu’ils sont paysagistes ou urbanistes, mais n’avaient jamais réfléchi à la question alimentaire ! L’alimentation est sans doute trop importante pour être visible.
MO – Serions-nous en train de redonner toute son importance à l’alimentation ?
CS – Ce mouvement est conduit en grande partie par des gens éduqués et riches, mais il est en marche. Encore une fois, considérer la question de la nourriture revient à se demander ce qu’est une bonne vie !
Propos recueillis par Stéphanie Lemoine
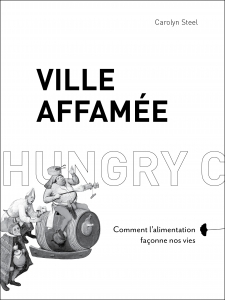 Carolyn Steel – Ville Affamée : comment l’alimentation façonne nos vies, Paris, éditions Rue de l’échiquier, coll. Initial(e)s DD, 2016, 448 pages, 25 euros
Carolyn Steel – Ville Affamée : comment l’alimentation façonne nos vies, Paris, éditions Rue de l’échiquier, coll. Initial(e)s DD, 2016, 448 pages, 25 euros
